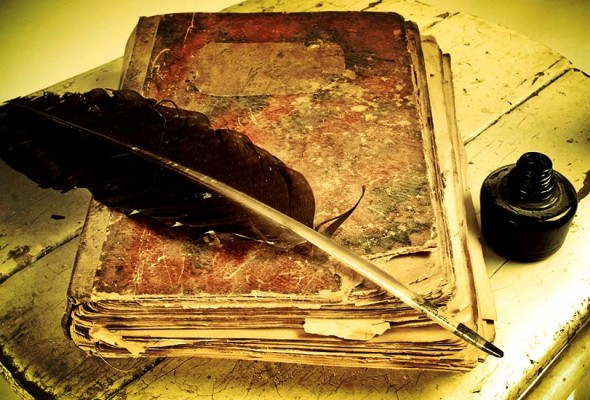par Florent Jullien
Dans d’autres pays, à d’autres époques, les enfants doivent travailler pour vivre et sont privés de tout accès au savoir. La République s’honore en leur offrant l’instruction ; elle s’assure aussi elle-même, tant ses fondements reposent sur une communauté de citoyens libres et éclairés. Il est donc normal d’entendre le chœur unanime des dirigeants donner « la priorité à l’éducation ». Mais, comme souvent, le diable est dans les détails, en l’occurrence dans ce qu’on appelle offrir l’instruction. Et si deux logiques s’affrontent aujourd’hui en ce domaine, c’est sur le cadavre de l’École républicaine.
La « logique » libertaire
La première logique est celle de notre État post-moderne et bonasse, grande maman sacrificielle et christique, qui donne sans retour. Des sommes colossales se déversent continûment sur les nouvelles générations. Elles n’écoutent pas, méprisent ou saccagent les moyens matériels et humains qu’on leur consacre ? On en déverse davantage. Parfaitement anachroniques, les dirigeants, les formateurs et les médias s’attaquent chaque jour davantage à l’École de Dickens, comme si nous vivions encore au temps des pensions sordides et des châtiments corporels. Du Code de l’Éducation aux stages de formation, des Diafoirus de la pédagogie aux administrations des rectorats, on n’a qu’une préoccupation : défendre les élèves contre le sadisme de l’institution et leur garantir sans cesse de nouveaux droits, y compris celui de ne respecter aucun devoir. Qu’on les abandonne ainsi à eux-mêmes et aux rapports de force du groupe, qu’au nom de « l’Amour » on les prive d’instruction, cela ne paraît gêner personne.
Ce tableau peut paraître outrancier. Il demeure de belles individualités, et des raisons d’espérer. Il y a des restes de rationalité dans le système éducatif, des survivances de dignité et de respect du savoir dans le comportement des élèves, parents et professeurs. Mais quel mérite ont-ils de préserver ainsi le sens commun quand tout est fait pour les en dissuader ! Alors qu’ils sont aujourd’hui méprisés ou pourchassés pour leur « archaïsme » ou leur « autoritarisme », notre tâche politique est de redonner l’appui de la loi et de l’institution à ces comportements vertueux. Il nous faut rendre à ces actes quasi-héroïques de résistance leur caractère de normalité.
La pédagogie du don absolu issue de Mai 68 a fort mal compris l’éducation, mais a parfaitement su s’emparer des postes de pouvoir. Elle dicte depuis quarante ans la Réforme permanente de l’École, les discours et les politiques des ministres, les périodiques « grands projets » et autres pseudo-concertations, les pratiques des administrations et des corps d’inspection. Elle fonctionne à plein, en particulier, dans ces camps de rééducation des professeurs que sont les IUFM et assimilés. La « communauté éducative » se préserve ainsi de tout corps malsain qui prétendrait encore « imposer un savoir ».
Le désastre actuel de l’éducation est l’œuvre de cette idéologie. Nous formons chaque année des centaines de milliers de bacheliers littéraires qui ne savent pas écrire, scientifiques qui ne savent pas compter, techniques et professionnels qui n’ont pas de savoir-faire. Mais ce manque de connaissances n’est rien à côté du manque de volonté. Avec tous ses milliards, l’Éducation Nationale produit des millions d’élèves fuyant le travail, sans curiosité, sans désir d’apprendre ni de s’élever. C’est bien parce que nous nous sommes imposés de ne rien imposer, et que l’objectif est l’enseignement de l’ignorance. Car il serait tout de même mystérieux de consacrer tant de temps et d’argent à la transmission du savoir pour y échouer avec tant de sûreté.
Quiconque accepte d’ouvrir les yeux peut constater aisément le désastre et comprendre ses raisons, que les grandes démonstrations des experts ministériels et médiatiques ont pour but d’occulter. Si un élève refuse d’apprendre, s’il insulte le professeur et empêche ses camarades de travailler, il continue sa scolarité et passe dans la classe supérieure comme si de rien n’était. Jour après jour, tous peuvent voir que paresser et désobéir n’entraîne aucun désagrément : pourquoi diable se donner de la peine ?
Aucune sanction véritable ni aucune sélection ne sont plus possibles dans l’École bien-pensante de « l’élève-au-centre ». L’institution s’est petit à petit retiré tous les moyens de l’autorité. C’est « l’École du respect », entendez le respect du naturel de l’enfant, de ses caprices et de ses préjugés. L’objectif est de laisser l’enfant tel qu’il est — on y consacre tous nos moyens. Le miracle, à ce stade, est qu’il subsiste encore des élèves qui travaillent et se comportent bien. Mais c’est sans doute un dangereux « archaïsme », et une raison d’aller plus loin dans la Réforme.
La logique libérale
Il y a bien une logique qui s’oppose aujourd’hui à l’offre sacrificielle libertaire : celle de l’offre économique libérale. Cette opposition n’est d’ailleurs que factice car le naufrage de l’École publique conforte inévitablement la logique du marché. Le système est éprouvé : on commence par détruire le service public, et on excipe ensuite de son inefficacité la nécessité de tout privatiser. Et à vrai dire, la logique libérale est moins absurde que la logique publique dévoyée par le libertarisme. Elle laisse un sens à la notion d’éducation, puisqu’elle suppose, par définition, qu’une demande rencontre l’offre, et qu’on accorde une valeur à la connaissance.
Réduire le savoir à son utilité économique n’est certes pas satisfaisant ; cette attitude intéressée peut engendrer une humanité bien triste. Cela vaut mieux cependant qu’un complet mépris. Quand la logique libertaire confond maître d’École et maître d’esclave et intime à l’institution de s’excuser du savoir qu’elle inflige, la logique libérale remet les choses à l’endroit. Celui qui gagne à la relation éducative, celui qui s’élève, c’est bien l’élève. Et si, au lieu de le voir sans cesse s’efforcer de fuir tout effort et éviter tout apprentissage, on le rendait conscient de la valeur — ne serait-ce qu’économique — de ce qu’on lui propose, on aurait déjà fait plus de la moitié du chemin.
Les bienveillants destructeurs de l’École, dans la longue série de leurs expérimentations pédagogiques, ne se sont jamais autant approché de l’Absurde en sa pureté que lorsqu’ils ont prétendu rémunérer les élèves pour leur présence en classe. Nous pourrions être tentés a contrario, pour échapper au pire, de promouvoir la démarche plus cohérente de l’économie de marché et, envisager de faire payer les familles pour le service éducatif. On constate en effet fréquemment que des élèves qui n’ont jamais voulu travailler en classe acceptent de faire des efforts pour des cours particuliers. S’ils avaient dû donner une pièce pour entrer à l’École le matin, sans doute l’auraient-il pris plus au sérieux. Mais prétendre échapper ainsi au désastre scolaire reviendrait à valider des conceptions anti-républicaines.
Car le futur proche de la Réforme permanente est aussi la raison d’être de son imposition partout en Europe : la nomenklatura des technocrates, bien aidée par les idiots utiles du pédagogisme libertaire, prend ses ordres des lobbies économiques libéraux. Ce n’est certes pas un hasard si on organise ainsi la perte de l’École publique, en la décrédibilisant par un laxisme suicidaire. Accueillir et retenir à toute force les plus paresseux et perturbateurs des élèves, les « mettre au centre du système » et, pour « ne pas les stigmatiser », contraindre tous les autres à leur rythme : cela ne peut que favoriser l’exode vers le privé. Et s’il peut y avoir chez les exécutants de ce grand projet beaucoup de naïveté bien-pensante, d’aspiration égarée à l’égalité et d’amour dévoyé, les « décideurs » ont, eux, la tête froide : il s’agit simplement d’appliquer à l’École les mêmes dogmes libéraux qu’on impose partout ailleurs. Il serait bien bête de se priver, pour d’obscures raisons philosophiques ou morales, du « plus grand marché du XXIème siècle ».
Ce que c’est qu’offrir
Une politique républicaine ne peut se satisfaire de la solution libérale. Une société dans laquelle seule une petite élite serait réellement instruite en laissant à la masse du bon peuple l’ignorance docile du pain et du cirque ; une époque qui délaisserait les plus hautes valeurs de l’esprit pour les seules compétences utilitaires et rentables — un tel univers est certes envisageable, nous sommes même très bien placés pour en distinguer la possibilité. Mais il serait socialement injuste et humainement réducteur : pour être à la hauteur de nos idéaux, nous devons prendre au sérieux à la fois l’égalité et la culture, et réinstituer l’École républicaine. Elle est la condition de possibilité de l’aristocratie populaire à laquelle nous aspirons.
Face à la logique libérale et à l’absurdité libertaire, que doit-on vouloir ? Comme en tout domaine : revenir aux fondements de la République, c’est-à-dire à l’unité des droits et des devoirs, de l’exigence et de la générosité ; et pour cela, avoir les idées claires sur ce que signifie offrir l’instruction.
Celle-ci ne peut se donner comme un objet à un récepteur inerte, encore moins rétif. On ne peut vraiment offrir qu’à celui qui consent à recevoir. L’éducation ne commence vraiment à prendre son sens — et à se distinguer du dressage — que lorsque l’élève perçoit qu’il travaille pour lui-même.
Il est normal que l’enfant ne soit pas immédiatement mature : la pleine autonomie signifiant la fin de l’éducation, on ne peut l’espérer d’emblée. Mais entre l’inculture capricieuse et la connaissance autonome, l’instruction doit susciter au plus vite chez l’élève un état intermédiaire et précieux : la reconnaissance de sa propre ignorance et la volonté d’en sortir. La suite en découlera naturellement : l’estime du savoir, le respect de l’institution et des maîtres, et les progrès les mieux établis.
On ne peut pourtant fonder la marche globale du système éducatif sur cette perspective idyllique — pas plus qu’on ne peut fonder l’ordre public sur la seule vertu des citoyens. Aussi faut-il suppléer aux défaillances de l’esprit philosophique des élèves par un système de récompenses et de sanctions. Ils sont ainsi conviés au travail et leur volonté orientée vers le bien — le leur et celui de tous. Idéalement, le recours à cet artifice laisse place peu à peu à la volonté personnelle, mais il constitue une étape nécessaire dans l’éducation. Vouloir l’expulser de l’École, c’est vouloir abolir l’École, et c’est commettre un contre-sens ravageur sur ce qu’est l’autonomie. Personne n’a la liberté infuse : elle doit se conquérir progressivement contre l’ignorance et la paresse capricieuse. Ce combat contre l’opinion et les désirs immédiats n’est jamais pleinement gagné dans une vie d’homme : on n’a pas le droit de laisser les enfants le mener sans assistance.
À l’École comme ailleurs, à l’École plus qu’ailleurs donc, il n’y a pas de don unilatéral. Offrir suppose que la personne veuille bien recevoir, et cet objet si fragile que l’éducation transmet, la sagesse ou le savoir autonome, suppose des égards tout particuliers. Offrir l’instruction vraiment, c’est la proposer à tous et non aux seuls fortunés ; cela nous éloigne de la logique libérale, pour laquelle l’offre n’a rien à voir avec le don et tout avec le calcul intéressé. Mais offrir l’instruction vraiment, c’est aussi exiger des élèves qu’ils la reçoivent : qu’ils aient des attentions pour le savoir, une préoccupation pour leur propre élévation. Et cette exigence disqualifie l’absurde logique libertaire qui prétend tout confier à leur spontanéité.
Retour aux principes
Nous n’avons pas la prétention en ces quelques lignes de donner un programme complet pour la réinstitution d’une instruction républicaine. Cependant, il n’en est nul besoin. La priorité pour l’École aujourd’hui ne consiste pas dans la constitution d’un registre délicat d’amendements techniques. Il convient surtout de ne pas être subtil. Pour abandonner d’emblée toute inhibition face aux faux doctes, assumons cette proposition : refonder l’École est simple. Cela s’explique : il suffit de faire le contraire de ce qui est fait depuis quarante ans. Nous voyons qu’il nous faut en particulier dédaigner l’accusation de passéisme, et cette rhétorique facile qui nomme crispation le sens du réel et de ce qui a fait ses preuves. Car si les instruments du savoir et les objets d’étude évoluent, les principes n’ont pas d’âge.
L’École se meurt de ne vouloir accepter cette alternative : l’élève apprend parce qu’il le veut ou parce qu’il y est contraint. Le libéralisme résout a priori la question en ne répondant qu’à une demande existante. La véritable République comprend les vertus de la contrainte : de même que l’obéissance à la loi libère, l’inculcation du savoir émancipe. Les ennemis de l’École se plaisent à la décrire ennuyeuse, pénible ; c’est parfois le cas, avant qu’on ne parvienne à faire aimer le savoir pour lui-même, mais ce n’est pas un argument ; c’est par essence que l’École est studieuse culture de l’âme, tout le contraire du plaisir immédiat, dieu des libéraux-libertaires. Mais de fait il ne s’agit plus aujourd’hui d’imposer l’instruction : pour notre époque avant-gardiste, seule la garderie est obligatoire. L’ultime effort disciplinaire que s’autorise notre système consiste à prendre et retenir toujours plus longtemps les individus dans ses mailles : non plus à partir de 6 ans mais de 4, 3, 2 ; non plus jusqu’à 13 ans mais jusqu’à 16, 18, 25 : quel progrès ! Sauf qu’on en sort propre comme un sou neuf, de cette grande machine, avec toute la fraîcheur d’âme et l’ignorance qu’on n’avait pas, jadis, au certificat d’études. Il faut en finir avec ce totalitarisme mou qui s’empare d’un quart de siècle de l’existence humaine pour n’en rien faire, et rompre avec la politique du chiffre : imposer moins longtemps l’École mais l’imposer vraiment.
Mais est-ce encore possible, alors que l’idéologie de 68 s’est alliée avec celle du marché pour discréditer tout principe autre que le désir immédiat ? Quand une administration démissionaire n’organise plus que la rencontre anarchique de professeurs désemparés et d’élèves non concernés, la première des urgences est de rétablir l’autorité. Il faut rappeler fermement que l’obéissance aux règles de la raison et du bien commun structure la relation éducative. Une inégalité constitutive y règne, qui soumet les opinions de l’enfant à l’objectivité du savoir et ses caprices aux valeurs de la civilisation. Et cela n’est pas un « sombre relent des oppressions du passé », mais la voie d’une émancipation véritable.
L’autorité est celle du savoir avant tout. C’est lui seul qui donne sens à l’instruction. Il faut en finir avec ces réformes pédagogiques permanentes qui ont prétendu éradiquer en quelques dizaines d’année une conception millénaire de la culture — et y sont largement parvenues, on ne peut leur dénier cette redoutable effficacité. Seul peut donner son sens à l’École un programme de connaissances disciplinaires précises, organisé de façon cohérente et progressive. Là encore, il faut demander moins pour obtenir davantage : l’enseignement doit d’abord être élémentaire et limité à quelques disciplines fondamentales. Savoir s’exprimer dans sa langue maternelle ; connaître les grandes étapes de l’histoire de son pays, les repères fondamentaux de sa géographie ; être initié aux premiers principes des sciences. Imposer cet apprentissage aux enfants, ce n’est pas les opprimer ; lire, écrire, compter, ce n’est pas ringard. Aux bonnes âmes qui imposent une extension indéfinie des apprentissages à l’École élémentaire, il conviendra de rappeler ce que sont des éléments. Seule la maîtrise approfondie des principes de tout savoir permet ensuite de développer, préciser et nuancer la pensée ; cela sera donné de surcroît : à chaque jour suffit sa peine. Au lieu de quoi, l’entassement anarchique des « initiations » et autres « explorations » dès le plus jeune âge ne produit qu’une irréversible confusion dans les esprits.
L’autorité est ensuite celle du professeur et de l’institution, en tant qu’ils servent le savoir. Là encore, il convient de prendre le contre-pied de la réforme permanente imposée depuis quarante ans. À l’École comme ailleurs, les rodomontades sécuritaires de la droite et les discours de générosité enflammée de la gauche se sont traduits par les mêmes politiques de laxisme et d’abandon. Il faut réarmer l’École contre tout ce qui la mine et que le système s’applique chaque année à consacrer davantage : droit à la paresse et au chahut des élèves, influence des propagandes médiatiques et publicitaires, pressions des parents et des intérêts de la société civile…
Mais au-delà d’une grande déclaration de principe, ce point demande d’être étayé par l’indication de mesures concrètes. On a raison, sans doute, de réfléchir aux grandes évolutions de la société, idéologiques ou techniques, qui rendent la transmission du savoir problématique. Cependant, si le rôle des médias et du téléphone portable ou bien la prégnance de l’hyper-individualisme contemporain sont des données à prendre en compte, il ne faut pas qu’elles servent d’excuse à l’abandon des principes. L’École de la IIIème République a su s’imposer dans un contexte au moins aussi difficile en luttant contre l’influence de l’Église, la puissance des langues régionales, le travail des enfants… Il y a sans doute des quartiers où rien ne pourra se faire sans une intervention plus globale des pouvoirs publics ; mais dans la grande majorité des établissements scolaires, l’institution aurait la force de faire respecter le savoir et le bien commun. Il suffirait qu’elle le veuille, c’est-à-dire qu’elle croie un peu en elle, et qu’elle accepte d’imposer les quelques règles indispensables à l’instruction.
Que faire ?
Comment ne pas comprendre que s’interdire de sanctionner les élèves perturbateurs, c’est priver l’ensemble de la classe de toute éducation ? Ou qu’en éliminant les redoublements, on conduit les élève en difficulté à un échec certain — à moins, solution de plus en plus adoptée, qu’on ne condamne toute la classe supérieure à la répétition des apprentissages du niveau inférieur ? Ici comme ailleurs, la comédie de la résistance à l’oppression de l’État est un contre-sens : l’affaiblissement de l’institution consacre les injustices sociales. Pour constituer un contrepoids aux inégalités de l’héritage, l’École doit bien plutôt retrouver l’autonomie sans laquelle elle ne peut préserver une sélection par le mérite. Collégiales et régulées, sans doute, informées et justifiées, ses décisions en matière d’évaluation, d’orientation et de sanction doivent être souveraines.
Les libertaires croient faire preuve de générosité en supprimant les redoublements. Les libéraux ont la même pratique, pour des raisons d’économie. On ne peut certes attendre ni des uns ni des autres qu’ils se soucient du savoir pour lui-même ; mais d’après leurs propres points de vue, cette pratique est absurde. Est-il généreux de priver un élève d’instruction ? Est-ce un bon investissement ? Là encore, le bon sens doit s’imposer contre les sophismes des experts : l’élève ne doit pas quitter un niveau d’enseignement tant qu’il ne le maîtrise pas. C’est cela, la véritable générosité et le véritable intérêt économique, sans parler de l’intérêt supérieur du savoir. Il vaut mieux consacrer une période supplémentaire à acquérir des bases plutôt que de les sacrifier et d’être ainsi rendu durablement inapte aux développements postérieurs. Pour le bien de tous, il faut en finir avec notre système ubuesque où l’on se débarrasse des pires élèves par le haut, vers la Faculté consternée, les entreprises horrifiées. Le passage en classe supérieure doit être soumis à une décision des professeurs, étayée par les résultats de l’année, ou mieux encore, par un examen final. — Aucune pratique n’étant plus juste que l’examen disciplinaire, national et anonyme, on voit que l’époque est conséquente en criant haro sur le baccalauréat, « coûteux » et « traumatisant ». Ce dernier môle de résistance à la destruction de la méritocratie républicaine pourrait au contraire être un modèle pour tous les niveaux d’enseignement. Pour le moins, la réussite à un examen devrait conditionner l’entrée au collège, puis au lycée. On pourrait rendre le système plus souple en instituant, sur le modèle universitaire, une session de rattrapage en septembre. Mais si les modalités peuvent se discuter, le principe restera intangible : la décision doit revenir à l’institution, selon le critère du savoir.
La même attitude prévaudra pour l’orientation, et pour toute orientation. Parce qu’il reste quelques velléités d’exigence dans certaines filières, on crie à l’injustice et on veut abolir toute sélection. La justice régnera au contraire par la sélection et la discrimination, c’est-à-dire l’évaluation rationnelle — mais ce sera par la sélection universalisée : toutes les filières doivent se mériter. Si l’École refuse de prendre ses responsabilités, elle se dissout elle-même, et laisse la sélection se faire selon d’autres critères que le travail et le savoir. Il n’y a pas de raison cependant de saborder certaines filières pour en privilégier d’autres. En particulier, ce n’est pas parce qu’on ne montre pas les qualités suffisantes pour aller dans une série qu’on est qualifié pour d’autres réputées plus faibles. Il convient d’opérer cette révolution copernicienne — qui n’est là encore que le retour au sens commun — en particulier pour sauver l’enseignement technique et professionnel. Les élèves méritants et intéressés y sont aujourd’hui noyés par la masse des élèves perturbateurs et paresseux, que le système veut absolument « garder » et « faire passer », au détriment de tous. Et le redoublement lui-même doit se mériter : car on peut bien être généreux envers celui qui a des difficultés, mais conserver dans les classes certains élèves ne leur sert à rien et nuit aux autres. Les bien-pensants qui s’offusquent qu’on puisse vouloir « priver d’éducation » les chahuteurs ne veulent pas voir qu’en leur donnant tous les droits, ils privent trente autres de celui d’apprendre.
Outre l’évaluation et la sélection, l’École ne peut se passer de la sanction. Nous l’avons vu : l’idéal serait que chaque élève perçoive l’intérêt qu’il a à bien se comporter et travailler sérieusement. Mais les adultes eux-mêmes n’ont pas toujours cette aptitude à maîtriser leurs désirs immédiats au nom de l’intérêt bien compris ; ce pourquoi chacun accepte (de moins en moins, certes…) que l’État impose le bien commun par la contrainte. Or, c’est l’essence même de l’éducation que de diriger. Soit donc l’élève se laisse conduire volontiers, et c’est parfait, soit il résiste. Deux possibilités s’ouvrent alors : la contrainte ou la liberté — plus exactement le laisser-aller. La solution la plus généreuse n’est pas celle qu’on croit, et c’est l’exigence de la République qui fait sa générosité. Jusqu’à un certain âge donc, c’est la contrainte qui doit primer. Tant qu’on estimera utile et juste l’instruction de tous, il faudra se donner les moyens de la réaliser. On ne laissera pas l’élève paresseux ou récalcitrant échapper à l’éducation, « ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre », selon la formule de Rousseau — qui gênerait bien ses zélotes pédagogistes s’il leur venait à l’esprit de le lire. À chaque degré de refus correspondra un degré de contrainte adapté. Les sanctions doivent d’abord être légères, mais systématiques et simples à mettre en œuvre ; pour ceux que ce premier degré de mesures n’arrête pas, leur pénibilité doit augmenter jusqu’à ce qu’elles deviennent dissuasives. Le principe d’économie s’applique : il faut le moins de contrainte possible, mais toute la contrainte nécessaire pour que force reste à l’institution. Dans les cas les plus sérieux, une mise à l’écart s’impose. Des établissements et des pratiques adaptés à un rapport de force plus élevé que la normale pourront produire un effet positif sur le récalcitrant. Tout aura ainsi été fait pour l’élever ; si cela ne réussit pas, du moins aura-t-on préservé la possibilité de l’instruction pour les autres élèves.
Cependant de telles solutions ne peuvent être que provisoires et limitées. En République, le principe de générosité doit trouver sa limite dans le principe de liberté. Il faut le plus tôt possible prendre acte de la volonté des personnes et les laisser être responsables de leur propre existence. L’instruction leur est offerte ; si elles n’en veulent pas, grand bien leur fasse. On peut réussir sa vie sans être docte. On peut aussi redresser ses erreurs au contact de la réalité : si l’École sait laisser partir celui qui la fuit, elle sera aussi magnanime en accueillant le retour du fils prodigue. Mais elle doit être capable d’accepter un échec pour ne pas aboutir au désastre : que certains ne profitent pas de l’instruction, cela est regrettable, mais ne doit pas conduire, comme aujourd’hui, à sacrifier les autres à leurs caprices. Que celui qui méprise l’instruction aille voir ailleurs : très bien ! Ou très mal, peu importe — mais qu’on ne règle pas le monde à son humeur !
—
On ne fait rien pour retrouver l’harmonie sociale en encourageant les délinquants par des analyses et des pratiques bien-pensantes ; de même, on ne « refondera » pas l’éducation, comme c’est à la mode de nos jours et depuis quarante ans, en se modelant sur les attentes de ceux qui la méprisent. Nul besoin d’une énième grande réforme de l’École : il suffira qu’elle retrouve un peu de bon sens et de dignité.
Certains élèves sont vraiment méritants de l’estimer encore, alors qu’elle se complaît dans l’humiliation. Pour ne pas les abandonner, ni le savoir, à la barbarie, il est impératif de redonner sa fermeté à l’institution. Contre toutes les pressions de la société civile, des petits caïds et des grands experts, des marchands et des bien-pensants, il faut poser à nouveau que l’École vaut par elle-même, absolument. L’appétit intellectuel qui, malgré un contexte désarmant, persiste chez beaucoup nous encourage à tenir ferme sur l’essentiel : les exigences du savoir et de la liberté ne se négocient pas ; c’est un privilège, un honneur et un bonheur de pouvoir s’y plier.